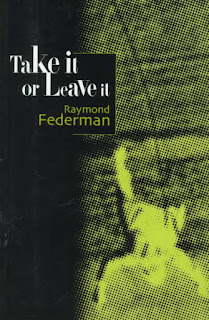Rechercher dans ce blog
"Le totalitarisme a inventé son invisibilité" (Cédric Demangeot)
Articles
Affichage des articles du octobre, 2016
L'homme chauve sourit enfin
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur "Jérusalem" d'Alan Moore sans oser le demander
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
L'indépassable horizon du ridicule: bienvenue à Jardin-Land.
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
La photo (brisée) du jour
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Anti-manuel de suicide
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Cartonner n'est pas jouer
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Stéphane Bouquet: la stupeur d'exister
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Qu'y a-t-il hors du charnier natal ?
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Raymond Federman, une traduction à prendre ou à laisser
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
L'incroyable vérité sur l'affaire du prix Dylan de littérature attribué à Bob Nobel (sic)
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Le palais des peines perdues: "Témoin", de Sophie G. Lucas
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Béziers, expert es-hontes
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Il n'y a pas d'affaire Elena Ferrante
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Le ninja et la méduse: ou les métaphores du traducteur
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Le coefficient de foisonnement
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Tentative d'épuisement du traducteur
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Les larmes de Pouchkine, le sourire de Markowicz
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Pensées paresseuses d'un traducteur
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications