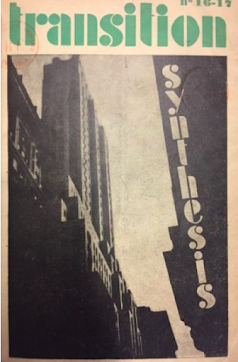On peut, bien sûr, élever des tombeaux au moi, leur donner la forme d'un divan, et inviter le lecteur à s'y prélasser ou s'y tortiller pendant quelques centaines de pages – l'encre pour ce faire arrive aisément à qui sait orchestrer le dialogue entre extérieur et intérieur, entre soi et le monde, entre douleur et public. Mais il arrive parfois qu'en moins de cinquante pages on évite une telle dépense et qu'on aille plus profond, qu'on touche plus juste. Et qu'on épargne ainsi aux autres, "l'impératif moderne de l'expression de soi". Raison pour laquelle, en cette rentrée littéraire forcément bavarde, on contournera les imposantes piles de l'auto-affliction pour se concentrer, non sur un petit bijou ciselé (nul bobinade ici…), mais sur un livre-caillou, qui tient dans la poche et pourra faire tout ce qu'un caillou sait faire: briser une parcelle de mer gelée, attirer le regard, mesurer une distance, débusquer des leurres. Il faut un frère cruel au langage, de David Bosc, en est le titre, et il s'agit d'un emprunt déformé à Mandelstam: "Il faut un frère cruel au monde / qui puisse lui mener la vie dure."
En quelques dizaines de pages, David Bosc – dont on avait pu lire le magnifique Mourir et puis sauter sur son cheval (Verdier, 2016) – bat en brèche cette idée faisandée (mais juteuse) que l'écrivain obéit à des intentions, et que celles-ci sont le produit de son moi. "Sans même parler d'une œuvre entière, roman ou poème, il n'est pas une phrase, pas un vers où le langage n'ait eu son mot à dire, justement, et où chaque mot, après avoir été prononcé, inscrit, n'ait eu son incidence sur l'apparition des suivants." Est-ce à dire qu'on ne fait, écrivant, que dérailler, être dupe, manquer à son devoir, rater sa cible? Bosc explore précisément ce jeu de dupe, qui explique que nombre d'écrivains s'illusionnent sur leur puissance d'expression, à proportion de l'ego dont elle jaillit. Pour l'auteur de Il faut un frère cruel au langage, nous sommes hantés par des meutes obscures, bancales, nées du vaste brassement langagier des siècles. On écrit avec une armée de soudards et de mutilés, mais aussi contre elle. Bien sûr, ce tohu est aussi bohu, mais il permet "de se libérer un peu de soi-même", et de travailler à ce que Bosc appelle "le désarroi du langage", en rappelant le sens du mot arroi (ordonnancement des choses). On ne s'étonnera pas qu'il cite Deleuze à la page 13, ainsi qu'un passage du Woyzeck de Büchner.Prépondérance, donc, du motif, plutôt que de l'intention. Un motif-moteur, qui anime, propulse, propose, change la donne des possibles. Et fait qu'écrire est, d'emblée, une opération à plusieurs niveaux, tous plus ou moins simultanés. Le premier jet? C'est déjà une brassée de fontaines. L'amour des mots? Un piège obscène, quand on sait que le langage est "archaïquement la voix qui se fait obéir." Nous sommes souvent les otages du langage et croyons en avoir fait notre joujou. Mais "le pouvoir est entré dans la place, au cœur du petit fortin, rien moins qu'étanche, qu'on appelle le moi." Pour Bosc, il faut être "ravi", c'est la condition poétique inaliénable, c'est-à-dire "savoir laisser venir" et consentir à l'emprise de démons, d'instances, d'entités fictionnelles, grâce auxquelles on devient foule, et non plus pivot. Entrer dans la langue en cheval de Troie et chevaucher la nuit à cru, plutôt que transformer son ego en tête de gondole.
__________________________
David Bosc, Il faut un frère cruel au langage, Héros-Limite, 8 €