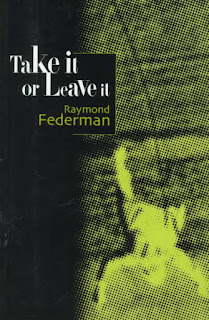Grâce à Alexandre Jardin, l’amour
est désormais à la portée des caniches, qui plus est sous forme de croquettes
stylistiques. Dans son « dernier » roman, Les Nouveaux Amants, notre cardiologue des passions tente le tout
pour le tout et dissèque le grand lapin sanguinolent d’une liaison vouée, tout
comme son livre, à l’échec. Oui, une fois de plus, Jardin joue avec des
allumettes ignifugées pour nous expliquer la Flamme, son vit, son nœud,
inventant pour l’occasion un Valmont sous tweeter et une Justine sous valium.
Précisons d’emblée que son roman, hélas pas assez novateur pour la collection
Harlequin, s’est mis en tête de fricoter avec la forme. Oui, l’auteur a donné à
son pensum l’allure extérieure d’une pièce de théâtre. Mais comment diable
a-t-il réalisé ce faramineux tour de passe-passe ?
Autant que vous le sachiez tout
de suite : au lieu d’intituler ses chapitres « chapitre », il
les intitule « scène » – son roman/théâtre comportera donc près de
soixante-dix scènes, mais hélas aucun « acte », même si le rideau
tombe avec la régularité d’un tranchoir à boudin. Dois-je vous spoiler
l’incroyable histoire que Jardin a décidé de nous narrer aussi
théâtralement ? Essayons : un écrivain parisien célèbre trompe
sa femme belle mûre actrice avec une jeune et jolie métis mariée délurée de province.
Ils résistent, cèdent, résistent encore, cèdent de nouveau, ce qui laisse
supposer au bout d’un moment un défaut de fabrication. Précisons que le héros,
Oskar Humbert – on ignore si Jardin a voulu dissimulé le mot « carambar »
dans son nom… – écrit une pièce de théâtre, qu’il customise à mesure que sa
passion avec Roses Violente – no comment
– s’exalte et se délite. Il y a même une scène dans la suite Bovary d’un
boutique-hotel, pour ceux qui ont des lettres et du temps à perdre. Mais
laissons reposer la pâte du sujet, qu’éclipse sans scrupule une écriture… une
écriture… comment dire ? Ici, le terme « écriture » est
impropre. Car Jardin veut tellement sonder la psychologie de ses personnages, lesquels
ont pourtant l’épaisseur de gaufrettes virtuelles, qu’il finit par faire de son
style une entreprise coloscopique.
Bien décidé à pilonner son sujet
(et le lecteur avec), Alexandre Jardin en vient à écrire comme si l’expression
« pédaler dans la choucroute » était un mot d’ordre, une contrainte
jubilatoire, ou pire, une technique imparable. Il met Sami et Gondis dans un
pédalo et hop ! vogue la galère sur son petit lac de chou ! Mais
entrons dans le vif du sujet sans prendre de gants et en restant sourd aux cris
du récit malmené…
C’est désormais un fait
acquis : Jardin jardine, sans doute pour ratisser large, mais sa phrase
n’arrose hélas qu’elle-même. Emporté par sa plume pubère, il trousse les poncifs
comme des dindes, au point de leur faire rendre farce. Sa prose est tellement acculée
qu’elle ne recule devant rien. Ainsi, décrivant l’œuvre de son héros, il
n’hésite pas à se fendre de ce qui doit être une phrase :
« Les pièces pressées de Humbert étaient autant de
miroirs promenés le long de la route du plaisir qui déverrouille les désirs et
interdit l’érosion de soi. »
Je suppose naïvement que c’est le
plaisir qui déverrouille, pas la route, mais qu’importe, du moment qu’on
« interdit l’érosion » du moi. Les généralités, ont le sait, ne font
pas peur à Jardin, et pour cause : c’est lui qui les effraie, les
obligeant à grimacer. Sa science de la nature humaine, combinée à un sens
bricolo de l’allégorie, donne ce genre de chef-d’œuvre :
« Une femme est comme une
commode faite d’une multitude de tiroirs visibles et de tiroirs secrets
renfermant eux-mêmes d’autres tiroirs qui ouvrent d’autres tiroirs… dans
lesquels on trouve encore d’autres tiroirs qui excitent
l’imagination ! »
C’est sûr : un tiroir qui
ouvre un tiroir, ça excite l’imagination. La femme, cette commode. Pratique,
non ? Tout est relatif, me direz-vous. Eh bien, justement, à propos de
relatives, Jardin n’a pas son pareil, sans doute parce que l’idée de caresser
un qui-qui le stimule :
« Il lui fallait conserver
une preuve qu’elle n’avait pas rêvé
ces mots improbables qui lui
confirmaient qu’il était possible,
certains jours, de se désengluer du réel pour empocher sa part de
bonheur. »
Quel prestidigitateur ! One, je me désenglue ; two, j’empoche. Cet art consommé du
simultanéisme, on la retrouve à tout moment, comme si Jardin aimait faire deux
choses en même temps, sans se rendre compte qu’il les oblige ainsi à une forme
brouillonne de sodomie syntaxique. Exemple (parmi cent, que dis-je ?
parmi mille !) :
« Son sourire un peu crispé
laissa filtrer sa répugnance pour l’inattendu, comme une alarme de son goût
pour la tranquillité. »
Il faut dire que ses personnages
n’ont pas la psyché facile : ils sont, tour à tour, ces pauvres carnes,
« puceau du vertige », « toqué d’engagement »,
« pétrie de lenteurs », « lustrée de lettres »,
« rongée de culpabilité », « avide de quiétude
rectiligne », « tremblant d’émotion », « gourmande de
sensualité », « englué dans le chagrin », « glacé d’horreur »…
Qualifier : telle est la grande mission de Jardin, qui ne veut laisser
aucun recoin de l’âme inexploré, et pour cela colle partout des étiquettes
portant le nom de la chose. En plus, tout ça baigne dans la modernité :
les deux amants sont tellement connectés – tweeter, facebook, whatsapp, skype –
qu’on se demande pourquoi ils boudent myspace. (Mais comme ils doivent skyper
discrètement, ils coupent le son et brandissent devant l’écran des feuilles
avec des mots inscrits dessus – sans doute une métaphore de la façon dont
Jardin conçoit l’écriture…)
Passons sur la manie
interrogative qu’il partage avec Zeller, Foenkinos et quelques autres, et qui
consiste à poser en permanence des questions. Bon, quand je parle de manie, je suis
en deçà de la vérité, car dans ce libre, les questions, eh bien il y en a pas
moins de six cents. Oui, on s’interroge énormément dans ce livre, un peu comme
si on passait son temps à frapper à une porte qui serait le front du lecteur. Le
plus effarant dans l’affaire, c’est qu’on sent que Jardin est content de lui, à
chaque phrase, à chaque tournure de phrase, à chaque retournement de phrase. Dieu
que ses phrases sont tournées ! Mais tournées vers quoi sinon l’horizon
indépassable du ridicule ? Là, encore, voici les faits : « Ils
avaient la faculté de se propulser l’un l’autre dans un étrange
somnambulisme. » Ou encore : « Jouissant littéralement de
desserrer sa bienséance… » Ou pire : « Son oreille semblait
dire… » Bonus : « Oskar prit sa main qui venait de délivrer son
dos. » Le pied, quoi.
Et quand ses phrases cessent de
jouer à pirouette-cacahuète, c’est pour sombrer dans l’idiotie absolue, grâce à
un sens de la formule qui laisse pantois : « L’amour doit être un endroit
où l’on déverse sa transparence. » Avec, parfois, des envolées féministes
comme on en a rarement vues : « Certains hommes font regretter aux
femmes de n’être qu’elles. »
Jardin n’a peur de rien quand il
s’agit d’aplatir le sens. Sa méthode est simple : plus c’est gros, plus ça
passe (les enfants sont priés de ne pas essayer dans la vraie vie). Exemple :
« La vie est à vivre. » (fin de la scène 15…). Je n’invente
rien : la vie est à vivre ! Notre auteur doit être finalement un peu
comme son personnage féminin, Roses, laquelle est – accrochez-vous – « prête
à snifer l’incohérence maximale qui, seule, lui procurait un shoot suffisant de
sensations ». Lui aussi a dû sentir en son tréfonds « l’émotion qui
induit à penser que l’on est vivant, malgré les déceptions qui engrisaillent
l’existence ». De toute
façon, c’était ça ou parvenir au constat suivant: « Impossible de laisser
les coudées franches à la joie très triste qui l’inondait ».
J’aimerais arrêter là, mais ça
serait dommage, car vous rateriez le meilleur. Oui, car il reste dans ce roman
« une cargaison d’images importunes qu’elle désirait éteindre » !
Etes-vous prêt à éteindre des cargaisons ? C’est parti ! Entrez
donc ! Venez visiter « les mystérieux rouages du cœur » !
Ce n’est pas sans risque, et peut-être ne voulez-vous pas finir comme Roses,
qui « noya son désappointement dans un Niagara de pensées fermes »,
même si l’érotisme forcément débridé auxquels se livrent les deux amants est
« sans défectuosité ». Oui, parce que bon, il ne s’agirait quand même
pas de « nier les turbulences à venir qui les usait par en dessous »,
quitte à « explorer les dédales de ses affinités avec
l’humiliation ». Non, non, non, hors de question.
Mais je capitule. Je n’ai pas
envie, comme Roses, d’être « emporté par une crue de larmes
inarrêtables ». Bien sûr, on me rétorquera qu’il est facile de sortir des
phrases de leur contexte pour les stigmatiser. Que le lecteur de ce blog me
remercie plutôt de lui épargner le contexte. Ou plutôt qu’ici, texte et
contexte sont inextricables, tous deux voués au dieu Charabia. En revanche, je
ne vous ferai pas grâce de la dernière ligne du roman, qui se trouve être une
« note de l’auteur », située en bas de page alors qu’on en était venu
à douter sérieusement que la page pût tomber plus bas :
« Ecrire, c’est ouvrir mille
portes. »
Là, j’ai envie de dire que mille,
c’est beaucoup. Surtout si elles sont déjà ouvertes. Allons, ne boudons pas
notre plaisir et finissons sur une note positive, une note optimiste, un
drelin-drelin nonpareil. Oui, tout n’est pas à jeter dans ce roman
hormonalement déréglé. Il y a parfois des fulgurances. Bon, il n’y en a pas
mille non plus. En fait, il n’y en a qu’une. Elle est facile à trouver, car
elle figure à la page 20, après laquelle on commence à se pincer pour vérifier
qu’on ne rêve pas. J’appelle donc à la barre LA fulgurance du livre :
« Ma sincérité est un
répertoire de bourdes. »
Je veux bien croire qu’Alexandre
Jardin soit sincère. Ceci expliquerait cela.
________________
Alexandre Jardin, Les nouveaux amants, éd. Grasset, 19 €
(non remboursables)